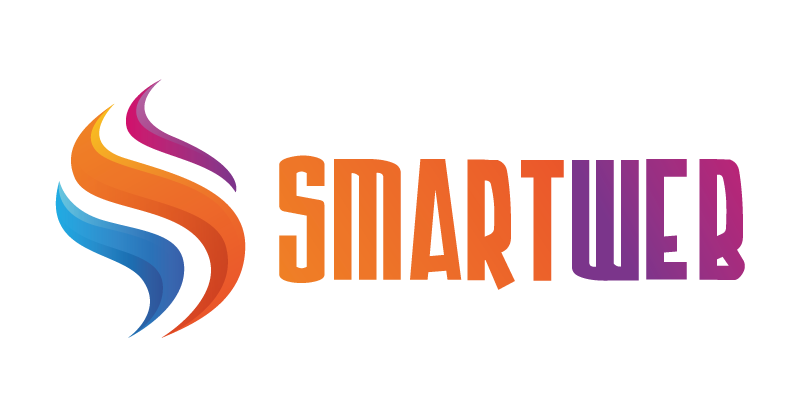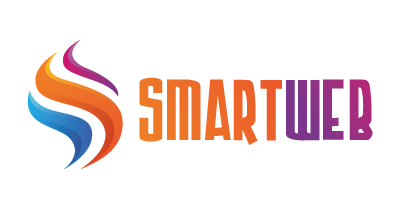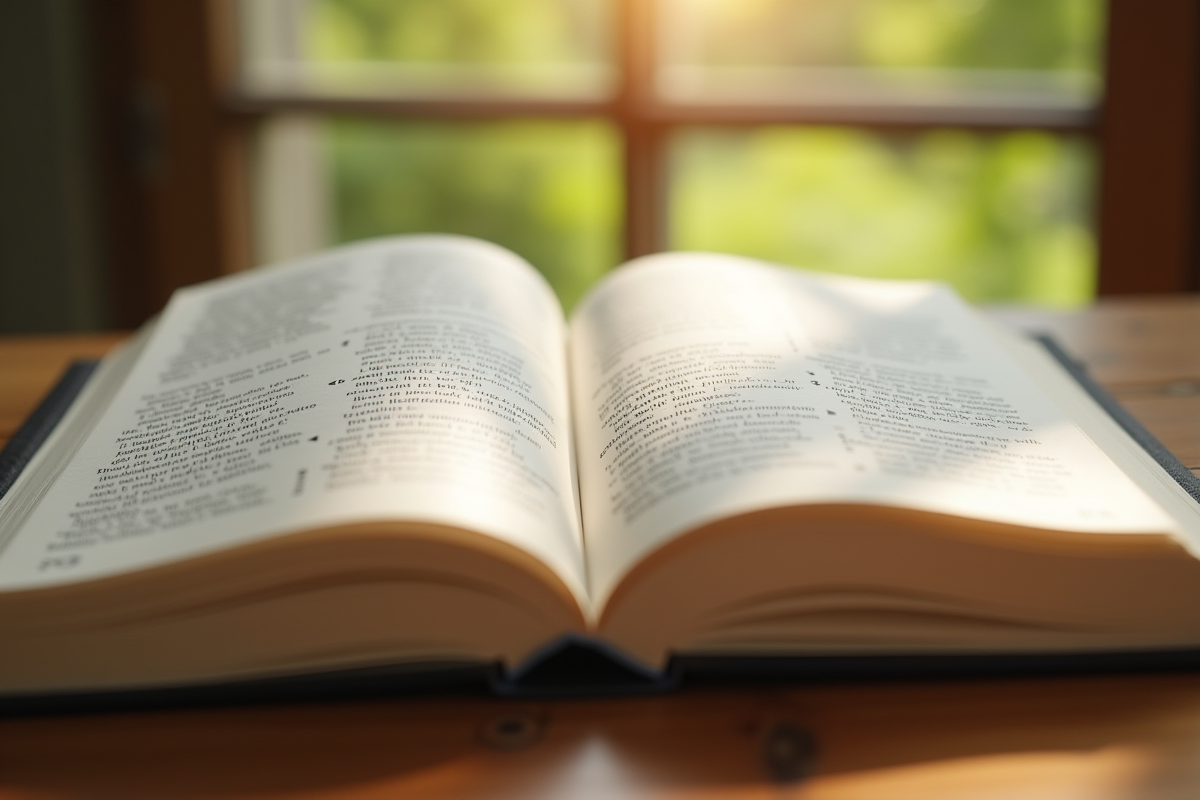La terminaison en « -it » ne s’applique jamais au participe passé du verbe « prendre ». Cette anomalie orthographique ne relève ni d’une exception récente ni d’une évolution du langage, mais d’une règle fixe, imposée depuis l’Ancien Français. Malgré la proximité graphique avec d’autres terminaisons verbales, la confusion persiste, alimentée par des conjugaisons régulières qui, elles, admettent le « t » final. Cette distinction s’inscrit dans une logique étymologique et grammaticale stricte, ignorée par de nombreux locuteurs.
La confusion entre « pris » et « prit » : d’où vient-elle ?
Dans la langue française, difficile d’ignorer l’embrouille entre « pris » et « prit ». Leur ressemblance ne doit rien au hasard. « Pris » occupe la place de participe passé du verbe prendre et s’utilise avec l’auxiliaire avoir pour former le passé composé : « il a pris », « nous avons pris ». Cette terminaison ne varie jamais, quelle que soit la personne.
À l’opposé, « prit » incarne le passé simple, réservé à la troisième personne du singulier : « il prit ». Ce temps, devenu rare à l’oral, continue de vivre dans les romans, les contes, et quelques discours officiels. La subtilité entre « pris » et « prit » tient à leur rôle dans la conjugaison des verbes du troisième groupe, une catégorie connue pour ses formes irrégulières et ses nombreux écueils.
La confusion s’invite souvent à l’écrit. L’erreur « il a prit » naît d’une hésitation entre la terminaison du participe passé et celle du passé simple. Pour s’y retrouver, il suffit de regarder la conjugaison du verbe prendre au passé composé :
- j’ai pris
- tu as pris
- il a pris
- nous avons pris
- vous avez pris
- ils ont pris
« Il a prit » n’a aucune place dans la grammaire française. L’idée d’un « t » final séduit parfois, sans doute par mimétisme avec le passé simple que l’on croise dans les romans, mais la règle orthographique ne laisse aucune marge de manœuvre sur ce point.
Pourquoi l’orthographe « il a pris » est-elle correcte ?
Le passé composé du verbe prendre s’écrit toujours avec l’auxiliaire avoir suivi du participe passé « pris ». Impossible d’y coller un « t » final : la terminaison demeure « -is », sans exception. La forme « prit » ne s’intègre dans aucune structure du passé composé.
Dans la tournure « il a pris », chaque mot a une fonction bien définie : « a » sert d’auxiliaire, « pris » de participe passé. Pour s’en assurer, voici la conjugaison complète au passé composé :
- j’ai pris
- tu as pris
- il/elle/on a pris
- nous avons pris
- vous avez pris
- ils/elles ont pris
L’accord du participe passé dépend d’un seul critère : la présence d’un complément d’objet direct (COD) placé avant le verbe. Exemple parlant : « la décision qu’il a prise » (ici, « prise » s’accorde au féminin avec le COD « décision »). En dehors de cette configuration, « pris » reste invariable, quelle que soit la personne ou le nombre.
La confusion entre « pris » et « prit » se nourrit souvent de la proximité avec le passé simple : « il prit ». Mais le passé composé réclame invariablement le participe passé, jamais la forme simple. Nulle règle orthographique ne vient justifier la construction « il a prit » dans les grammaires de référence.
Dès que le verbe s’accompagne de l’auxiliaire avoir au passé composé, seule la terminaison « -is » est correcte, et ce pour toutes les personnes du singulier et du pluriel.
Erreurs fréquentes et astuces pour ne plus se tromper
L’erreur « il a prit » s’incruste dans les rédactions, les échanges électroniques et les articles en ligne. Ce « t » final s’invite à cause du passé simple, « il prit », une forme fréquente dans la littérature mais presque disparue à l’oral. Ce faux pas révèle souvent une confusion entre participe passé et passé simple, deux temps bien distincts autant dans leur usage que dans leur conjugaison.
Le même piège guette d’autres verbes du troisième groupe. Par exemple, on écrit : « j’ai appris », et non « j’ai appri ». Le doute porte sur la terminaison, mais la constance domine : le participe passé se termine par -is pour « prendre » et « apprendre », jamais par « t » au passé composé avec l’auxiliaire « avoir ».
Voici un repère simple pour s’y retrouver au passé composé :
- « pris » se termine par « -is » (il a pris)
- « appris » respecte la même logique (j’ai appris)
Le participe passé ne s’accole jamais d’un « t » après l’auxiliaire avoir. Ce « t » marque exclusivement le passé simple, utilisé dans certains récits ou dans un style littéraire soutenu, comme dans « il prit la parole ».
Pour éviter la faute, un réflexe utile : lire la phrase à voix haute. Si l’auxiliaire « avoir » précède, la terminaison « -is » s’impose. Ce geste suffit à écarter le « t » superflu, et à respecter la règle grammaticale qui structure la conjugaison française.
Des exemples concrets pour retenir la bonne forme
La justesse grammaticale se confirme dans la vie courante comme dans les textes littéraires. Pour ancrer le bon usage du participe passé « pris », rien ne vaut des exemples tirés du quotidien ou de romans bien connus. On rencontre ainsi : « il a pris de bonnes résolutions », « elle a pris un congé sabbatique », « on a pris une navette ». Dans chaque cas, le verbe « prendre » se conjugue au passé composé avec l’auxiliaire « avoir », suivi d’un participe passé invariable.
La question de l’accord apparaît uniquement si un complément d’objet direct précède le verbe. C’est le cas dans la phrase : « il m’a prise ». Ici, le pronom « m’ » (me) désigne une femme, d’où l’ajout d’un « e » à « prise ». Ce détail, parfois oublié, souligne la précision de la règle : le participe passé s’accorde en genre et en nombre seulement si le COD se trouve devant le verbe.
Le français n’a pas la réputation de la facilité, mais la constance de ses usages littéraires offre un appui solide. Dans « Les Enfants tristes » de Roger Nimier, on lit : « il a pris le train de nuit ». Dans « L’Adversaire » d’Emmanuel Carrère : « il a pris la fuite ». Chez Marguerite Duras, « il m’a prise par la main » met en jeu l’accord au féminin. Jean Giono, Simone de Beauvoir, Jacques-Laurent Bost… tous utilisent ces structures sans jamais s’écarter de la règle grammaticale.
Voici une série d’exemples pour ancrer la bonne forme :
- il a pris de bonnes résolutions
- elle a pris un congé sabbatique
- on a pris une navette
- il m’a prise (féminin, accord du participe)
Face à la tentation du « t » final, garder la terminaison « -is » pour le passé composé, c’est miser sur la justesse et la confiance. Un détail qui change tout, et qui distingue l’œil attentif de celui qui confond vitesse et précipitation. Demain, une lettre mal placée ne fera plus vaciller votre phrase.