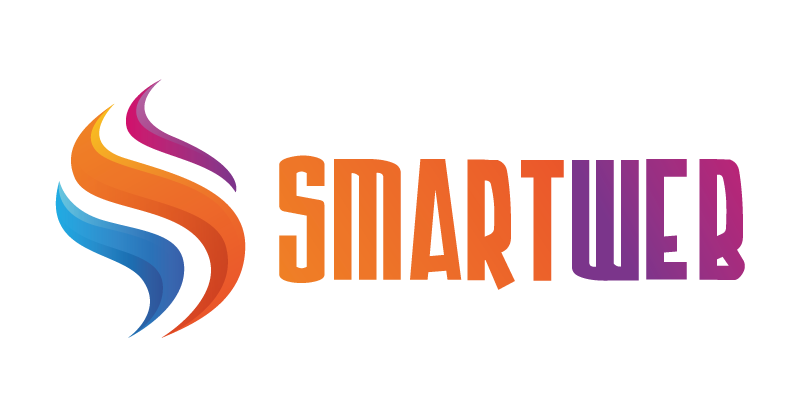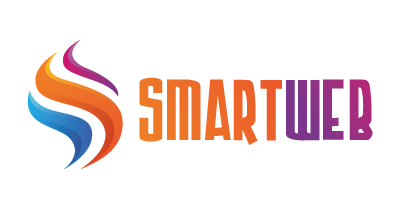Certains immeubles échappent encore à l’application de la loi ALUR, bien que celle-ci vise à renforcer la transparence et la gestion des copropriétés depuis 2014. Des copropriétés de moins de dix lots, ou celles dotées d’un règlement de copropriété antérieur à 1965, bénéficient de régimes spécifiques, parfois moins contraignants.
Des disparités subsistent concernant l’obligation de constituer un fonds de travaux, la réalisation de diagnostics techniques ou la tenue d’un carnet d’entretien. Ce statut particulier soulève des interrogations sur les droits, devoirs et responsabilités de chaque partie prenante, et sur les risques associés à une gestion moins encadrée.
La loi Alur en copropriété : pourquoi autant de changements ?
En 2014, la loi ALUR a redéfini les règles du jeu pour la copropriété, secouant un univers où défauts d’entretien et litiges s’accumulaient. Les intentions sont claires : stopper la dégradation du bâti, assainir la gouvernance des immeubles, et installer la transparence comme pilier central. Pour y parvenir, l’arsenal déployé est large : fiche synthétique, diagnostic technique global (DTG), fonds de travaux, immatriculation obligatoire… Chaque mesure cible une faille précise.
La relation entre syndic, syndicat des copropriétaires et assemblée générale se transforme. Le modèle du contrat de syndic devient unique, les marges d’interprétation diminuent, la rémunération se clarifie. L’extranet s’impose, le compte bancaire séparé devient la norme, et la transparence ne se discute plus. Pour les petites copropriétés, des adaptations sont prévues, histoire de ne pas étouffer les plus modestes sous la paperasse.
Avec la loi ELAN, le cap s’affirme encore : la gestion des travaux se structure, l’insalubrité est davantage anticipée. La loi Climat et Résilience, dernière en date, oblige à planifier les travaux sur plusieurs années, engageant ainsi la copropriété vers la transition énergétique.
Le cadre réglementaire s’est densifié, jonglant entre rigueur pour les grands ensembles et souplesse pour les petites structures. Au cœur de ces réformes, une volonté : protéger les copropriétaires et préserver le patrimoine commun.
Quelles sont les copropriétés réellement non concernées par la loi Alur ?
La loi ALUR a beau s’étendre à la majorité des copropriétés, il reste des poches d’exceptions, soigneusement prévues par la réglementation. Quelques structures, en raison de leur taille ou de leur fonctionnement, relèvent d’un régime allégé.
Dans la pratique, ce sont surtout les petites copropriétés qui concentrent ces dérogations. Voici les cas principaux concernés :
- Les ensembles comprenant cinq lots au maximum ou disposant d’un budget prévisionnel annuel inférieur à 15 000 euros.
- Ces copropriétés peuvent se passer de conseil syndical, adopter une comptabilité simplifiée et décider collectivement par consultation écrite.
Ce modèle offre une gestion de proximité, souvent portée par un syndic bénévole choisi parmi les copropriétaires eux-mêmes.
Les copropriétés horizontales, constituées de maisons individuelles sur un terrain commun, bénéficient aussi d’allègements notables. Leur gestion du budget et des travaux est largement simplifiée. Pour le compte bancaire séparé et l’extranet, les ensembles de moins de dix lots peuvent choisir d’y renoncer, à condition que l’assemblée générale l’accepte.
La taille, le nombre de lots et la destination (habitation, bureaux, commerces) définissent donc l’étendue des obligations. Certaines copropriétés exclusivement composées de bureaux ou réduites à deux lots échappent à plusieurs contraintes, comme la création d’un conseil syndical ou la mise en œuvre de contrôles complexes. Malgré tout, le règlement de copropriété reste le socle, quel que soit le profil de l’immeuble.
Zoom sur les obligations majeures : fonds de travaux, immatriculation, fiche synthétique
Même les copropriétés en marge des principales mesures de la loi ALUR doivent respecter des obligations structurantes. Trois points de vigilance principaux s’imposent :
- le fonds de travaux
- l’immatriculation au registre national
- la fiche synthétique
Chacun de ces piliers impose un cadre strict, y compris pour les petites copropriétés ou celles à gestion horizontale.
Le fonds de travaux : une réserve obligatoire
Pour anticiper les frais liés à l’entretien ou à la rénovation, la création d’un fonds de travaux est requise. Ce fonds doit être alimenté chaque année à hauteur d’au moins 5 % du budget prévisionnel, sur un compte séparé. En cas de vente d’un lot, la somme versée reste acquise à la copropriété. Les ensembles de moins de dix lots peuvent y déroger si l’assemblée générale le décide.
L’immatriculation : transparence au service de l’intérêt général
Toutes les copropriétés, même les plus petites, doivent être immatriculées auprès du registre national géré par l’ANAH. C’est au syndic, qu’il soit bénévole ou professionnel, de s’en charger. Cette formalité permet le suivi du parc immobilier et conditionne l’accès à certaines aides publiques.
La fiche synthétique : un outil de pilotage
Le syndic a aussi l’obligation de mettre à jour chaque année la fiche synthétique. Ce document recense les principales données financières, techniques et juridiques relatives à la copropriété. Il facilite la gestion et la prise de décisions collectives, tout en offrant aux copropriétaires une photographie claire de la situation de l’immeuble.
Conseils pratiques pour les copropriétaires face à la réglementation Alur
S’orienter dans la loi ALUR demande d’abord de bien identifier le périmètre des obligations. Selon que l’on se trouve dans une petite copropriété, avec un syndic bénévole, un usage de bureaux ou une organisation horizontale, la réglementation change et les marges de manœuvre aussi. Il s’agit de repérer les échéances, d’anticiper les démarches et de comprendre les limites du dispositif.
Pour assurer une gestion saine, choisissez un syndic compétent, professionnel ou copropriétaire investi : sa capacité à maintenir la fiche synthétique à jour, à gérer l’immatriculation et à présenter un budget lisible conditionne le bon fonctionnement de l’immeuble. Même si le conseil syndical n’est pas obligatoire dans les petites structures, il représente un atout non négligeable pour contrôler et accompagner le syndic.
Souscrivez à une assurance PNO (propriétaire non occupant) : la réglementation l’impose à tous, qu’on soit occupant ou bailleur. Pour les biens en location, la garantie Visale prend le relais de la garantie universelle des loyers, mettant les propriétaires à l’abri des impayés.
La mise en concurrence annuelle du syndic, devenue obligatoire, offre l’occasion d’optimiser le contrat et de renforcer la transparence. Le conseil syndical peut alors jouer pleinement son rôle en analysant les propositions et en négociant les termes.
Avant toute chose, contrôlez ces points clés pour sécuriser la gestion de votre immeuble :
- Assurez-vous que le règlement de copropriété est à jour : il reste la référence de toute organisation collective.
- Vérifiez la présence d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
- Demandez l’accès à l’extranet si votre syndic est professionnel.
Face à la complexité croissante de la réglementation, la concertation entre copropriétaires, le respect des échéances et la rigueur dans la gestion des fonds font la différence. Les textes évoluent : restez attentifs aux nouveautés de la loi Elan ou de la loi Climat et Résilience, qui poursuivent et amplifient la dynamique de la loi ALUR.
Le paysage de la copropriété, loin d’être figé, se transforme au fil des réformes. Savoir s’adapter, c’est garantir la pérennité de son patrimoine et la sérénité de la vie collective.